
Personne ne se risque à nier aujourd’hui l’importance de la crise écologique ni l’urgence climatique. Les ministres de l’environnement du G7, qui se réunissaient à Metz, dimanche 5 et lundi 6 mai, ont bien accusé réception du rapport de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) alertant sur la possible disparition, à brève échéance, d’une espèce sur huit, animale et végétale.
Dimanche matin, le premier point à l’ordre du jour du sommet était la présentation de ce rapport par le président de l’IPBES, Robert Watson.
Autant dire qu’aucun des sept qui composent le groupe des pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Italie et Japon), pas plus que les Etats invités pour l’occasion par la France, qui préside cette année le G7 (Chili, Egypte, îles Fidji, Gabon, Inde, Indonésie, Mexique, Niger, Norvège, ou encore le commissaire européen à l’environnement présent lui aussi) n’a cherché à minimiser l’importance des enjeux et des défis à venir.
Une charte sur la biodiversité, dite « de Metz » a été adoptée par tous les pays du G7 et par la plupart de ceux qui étaient présents. Non contraignant et dépourvu d’objectif chiffré, ce texte indique toutefois la nécessité d’« accélérer et intensifier nos efforts pour mettre fin à la perte de biodiversité », « encourager l’engagement d’autres acteurs », notamment le secteur privé, et « soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ».
La France se veut fer de lance
L’objectif est, pour la France en particulier et son ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy, de préparer en amont le rendez-vous majeur que sera la tenue de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (COP15) à Kunming, en Chine, à l’automne 2020. Cette réunion devra fixer de nouveaux objectifs pour la protection de la biodiversité, notamment après l’échec des engagements (2011-2020) pris lors de la convention d’Aichi, au Japon, en 2010. La diplomatie française veut aussi apparaître comme fer de lance dans cette bataille, alors qu’elle accueillera, en juin 2020, à Marseille, le congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
De fait, il s’agissait pour la plupart des participants au sommet de Metz d’élever la question de la perte de biodiversité au même rang d’urgence que l’est celle du réchauffement climatique depuis la COP21, accueillie par la France en décembre 2015. Cette question du climat a d’ailleurs été le principal point de désaccord entre les Etats-Unis et les six autres pays du groupe, comme le reflète le communiqué final de ce G7 de l’environnement.
« Nous nous sommes mis d’accord, mais ça n’a pas toujours été facile », a témoigné Svenja Schulze, la ministre fédérale allemande de l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire, à l’issue de la réunion, le club des sept reconnaissant « que les changements climatiques et la dégradation de l’environnement sont des défis mondiaux complexes et urgents ».
Mais la Maison Blanche a tenu à faire entendre sa voix. Un paragraphe spécifique précise la position de l’administration Trump : « Les Etats-Unis réitèrent leur intention de se retirer de l’accord de Paris et réaffirment leur ferme volonté de promouvoir la croissance économique, la sécurité et l’accès énergétiques, et la protection de l’environnement. »
La délégation américaine s’est toutefois inscrite en positif dans la plupart des coalitions et programmes spécifiques étudiés lors de ce G7, « défense des grands singes, des coraux australiens, gestion durable des déchets, économie circulaire, alliance pour les océans… », a détaillé, lundi après-midi, Andrew Wheeler, administrateur de l’Agence américaine de protection de l’environnement, dont François de Rugy et les autres ministres ont tenu à saluer la bonne volonté.
Communiqué commun à échelle variable
« Le communiqué commun n’était pas forcément évident, tant le multilatéralisme gêne les Etats-Unis. Mais sur le fond, ils restent engagés dans de nombreuses actions », a convenu un membre de la délégation française. « On va continuer à pousser [Les Etats-Unis] et à essayer de travailler encore avec le Brésil », a confié au Monde la ministre de l’environnement et du changement climatique du Canada, Catherine McKenna.
Ce communiqué commun à échelle variable vaut mieux qu’aucun communiqué, ont concédé les ONG qui étaient invitées à participer – trop brièvement selon elles – aux travaux, déçues par ailleurs que les ambitions ne soient pas plus marquées et les objectifs pas plus concrets.
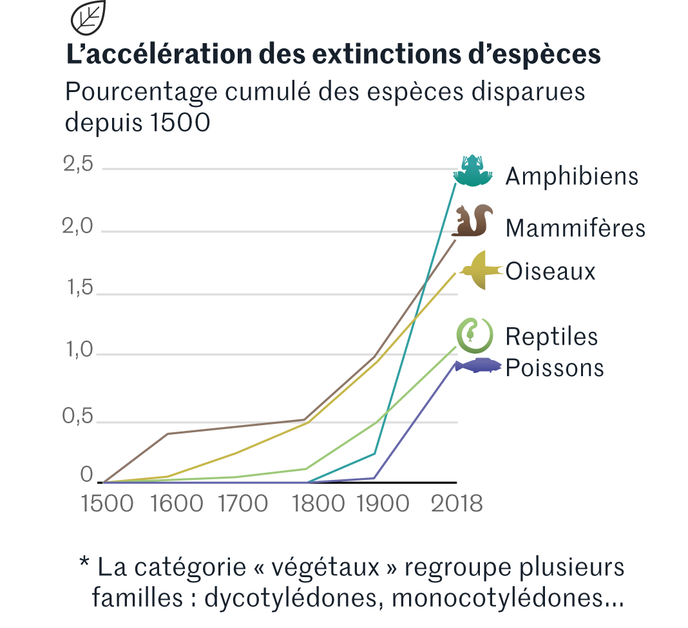
« Ce communiqué peut paraître accessoire, mais il ne faut pas oublier le contexte : en 2020, le G7 sera présidé par les Etats-Unis, alors que Donald Trump sera en pleine tentative de réélection, et le G20 [présidé] par l’Arabie saoudite. Autant dire, que rien n’avancera plus l’année prochaine », a rappelé Sami Asali, chargé de plaidoyer climat et développement durable à la Coordination SUD. Pour Lucile Dufour, du Réseau action climat (RAC), « ces déclarations d’intention étaient indispensables, mais font l’impasse sur des enjeux clés, comme celui de la fin des subventions aux énergies fossiles ». D’autres, comme Clément Sénéchal, chargé de campagnes politiques climatiques à Greenpace, ont dénoncé « le grand écart entre les beaux discours diplomatiques et l’inaction nationale ».



