Pourquoi l’individualisme, peu adapté à la survie de l’espèce, est à la hausse
L’homme est fait de contradictions. C’est un animal social qui ne peut vivre seul et en même temps, son besoin de liberté et sa volonté de puissance l’opposent perpétuellement aux autres. Si la socialisation est la stratégie adaptative la plus efficace, c’est pourtant l’individualisme qui a actuellement le vent en poupe.
A l’origine, la vie en société de l’homme, comme de tous les animaux sociaux a une origine pratique : assurer une meilleure survie de l’espèce. En groupe, on est mieux armé contre les bêtes sauvages, contre le froid et la faim. Oui, car s’il faut partager avec autrui les fruits de sa chasse, la traque collective permet d’attraper de plus gros animaux ou plus souvent. Rien de très différent de l’organisation en meute des carnivores, du vélociraptor au loup actuel.
Plus tard, c’est encore la vie en cité qui permet de protéger les récoltes des peuples nomades par l’érection de remparts. Ou de gérer efficacement la pénurie d’eau, comme en Egypte ou en Mésopotamie où l’irrégularité des crues nécessite très tôt une organisation centralisée pour distribuer les récoltes équitablement et assurer les travaux de canalisation. Une nécessité administrative qui donne naissance à l’écriture, mais c’est une autre histoire…
Parallèlement, l’instinct de survie promeut des comportements individualistes pour assurer sa propre perpétuation ou la promotion de son capital génétique, au détriment des autres. En témoignent le mâle dominant qui s’attribue la plus grosse part du festin, le lion qui tue les bébés félins pour éviter toute concurrence alimentaire ou sexuelles futures, le coucou qui pond dans le nid des autres oiseaux et casse les oeufs des rebelles (on appelle cela le comportement “mafieux” du coucou)… Les exemples dans la nature ne manquent pas de ces agissements égoïstes et asociaux, y compris chez des espèces qui vivent en communauté.
Dans la nature, c’est la loi du plus fort ou du plus fourbe qui règle les conflits. Mais l’homme comprend assez vite que cette loi naturelle n’est pas très efficace. Elle est trop gourmande en vies humaines, elle tue les meilleurs chasseurs qui privent la tribu de leurs force ou savoir-faire, elle fait disparaître les soldats les plus valeureux en des affrontements individuels stériles. C’est la raison de l’instauration de la paix et la trêve de Dieu par l’Eglise au 10e s, ou encore de l’interdiction des duels par Richelieu et Louis XIIIe au 17e s.
L’intelligence humaine pragmatique invente donc la loi, dont l’un des témoignages les plus anciens est le code babylonien d’Hammourabi vers 1750 av JC. C’est de là que vient la fameuse “loi du talion”, conçue pour l’époque comme une limitation de la violence. “Oeil pour oeil, dent pour dent”, c’est à dire stricte proportionnalité de la rétorsion et non pas escalade. En réalité, cette égalité ne touchait que les citoyens, les esclaves et les métèques (étrangers à la cité) étant bien sûr traités de manière très inégalitaire.
L’homme accepte de sacrifier une part de sa liberté et de sa volonté de puissance contre la sécurité. La sécurité du groupe contre les éléments extérieurs, mais aussi la sécurité contre la violence interne au groupe. Aussi fort soit-on, on n’est pas à l’abri du poison, de l’embûche et de la traîtrise. Raison pour laquelle tout pouvoir construit sur la force seule devient vite paranoïaque.
CHASSEZ LE NATUREL, IL REVIENT AU GALOP
Animal comme les autres, l’être humain reste toutefois soumis à des instincts puissants qui le poussent à l’individualisme et l’égoïsme, à différents degrés.
Le nourrisson monument d’égoïsme et d’égocentrisme ne songe tout d’abord qu’à l’assouvissement de ses besoins propres. Ce n’est que passés les 18 premiers mois qu’il prend pleinement conscience d’autrui et c’est son éducation qui l’amènera à composer progressivement avec les désirs des autres.
Mais nous gardons toute notre vie ce réflexe du “moi d’abord”, surtout si la période égocentrique s’est prolongée dans l’enfance.
C’est le cas de l’égoïste primaire qui privilégie son plaisir et sa liberté en toutes circonstances, sans se soucier le moins du monde d’autrui. C’est le “super-connard” si bien raillé par Omar et Fred : il porte un gros sac à dos dans le métro bondé, vous empêche de passer sur l’escalator en se mettant bien à gauche, présente tous ses bons de réduction à la caisse les jours d’affluence, se gare en double-file pour aller boire au bistro, bloquant ainsi la circulation…
Mais il existe un égoïsme plus subtil : celui qui englobe un groupe de personnes. Ne penser qu’à sa famille, ses amis, ses proches, c’est aussi de l’égoïsme, bien qu’elle ne concerne pas que sa seule personne. Si les autres ne sont conçus que comme une extension de soi, il ne s’agit pas d’altruisme, mais bien d’égoïsme déguisé. Combien de gens très sympathiques “quand on les connaît”, qui sont de vrais salauds avec tous les autres ?
On se souvient du syllogisme de Jean-Marie Le Pen pour justifier la préférence nationale : “je préfère mon frère à mon cousin, mon cousin à mon voisin, mon voisin à un étranger”. Cette hiérarchie sanguine ou géographique semble relever du bon sens commun. Plus on connaît quelqu’un, plus on a de chances de nouer des liens avec lui. Cependant, on peut ne pas souffrir son frère et adorer son cousin, ou détester son voisin et avoir de la sympathie pour un souriant inconnu. Et surtout, cet élan “naturel” ne signifie en rien qu’il est juste sur le plan moral. On ne saurait bâtir une organisation de vie en société sur nos instincts primaires.
C’est précisément la grandeur de l’être humain de vaincre ces derniers. On appelle cela la culture, ce qui s’ajoute à la nature, voire s’y oppose. Platon, dans le Banquet, recommande à ses disciples de commencer par aimer un beau corps, puis tous les beaux corps, pour en venir à l’amour de la vertu et des sciences, avant d’aboutir à l’amour du beau en soi. De la même façon, la sagesse nous incite à passer de l’amour de soi, à l’amour de ses proches, puis de ses voisins et enfin de l’humanité entière.
En cas de choix impérieux et vital, on privilégiera toujours sa progéniture, ses parents à une personne étrangère. Qui reprochera à une mère de vouloir d’abord sauver son enfant d’un immeuble en flammes ? C’est ce que nous dicte notre penchant naturel et il n’y a aucun mal à cela. Mais ce sont les circonstances particulières qui justifient alors ce choix cornélien. Choisir systématiquement une seule partie de l’humanité au dépend des autres, voilà ce qui est injuste. C’est le danger du communautarisme de repli : moi et mes semblables CONTRE les autres. La morale est dans l’ouverture à autrui, dans la mesure du possible.
Il n’y a pire danger que confondre l’émotion individuelle légitime, avec ce qui est juste et souhaitable pour la société entière. Le débat autour de la peine de mort est un bon exemple de cet antagonisme. L’argument classique avancé par ses promoteurs est : “si on avait assassiné ton enfant de cette façon, ne voudrais-tu pas tuer son meurtrier ?”.
Ma réponse est : si, probablement ! Et j’aurais tort, car la justice n’est pas la vengeance. Mais le plus important est que la société ne se fonde pas sur la juxtaposition des désirs individuels. On ne bâtit pas des règles macroscopiques sur une réalité microscopique. Cette décision me rendra-t-elle mon enfant ? Non. Cette exécution limite-t-elle la violence par son effet dissuasif ? Non. La mort est-elle irréversible ? Non. Y a-t-il eu des erreurs judiciaires par le passé ? Oui. Est-il plus injuste de tuer un innocent ou de ne pas tuer un coupable ? Tuer un innocent. La peine de mort est-elle une horreur morale ? Oui. C’est pourquoi la société doit choisir de brimer l’instinct individuel au profit d’une plus grande justice globale.
L’INTERET GENERAL, OBJET DE TOUTES LES CONVOITISES
La vie en société, de plus en plus urbaine, nécessite une adaptation plus précise et systématique de ses lois pour régler les conflits et arbitrer entre liberté individuelle et intérêt collectif. C’est l’invention du droit et la prolifération des légistes, dont Philippe le bel s’entoure pour donner une légitimité collective à ses décisions les plus autoritaires (procès contre les templiers, attentat d’Anagni contre le pape Boniface VIII).
Il incombe historiquement aux prêtres, d’abord, puis aux rois et plus tard aux élus de définir ce qu’est “l’intérêt collectif”, sur lequel repose tout le système. Et à chaque fois, une catégorie d’individus détourne cette notion pour servir ses desseins particuliers. Les prêtres et aristocrates inventent la féodalité pour assurer leur domination sur le peuple. Les Grecs et Romains créent des sous-classes d’hommes, du sénateur à l’esclave, du patricien au plébéien…
Le système tient, tant que le plus grand nombre floué croit à sa légitimité morale. Le paysan du moyen-âge endoctriné par un clergé plus ou moins intéressé, ne se sent pas victime des deux ordres qui le dominent. Point ne veut devenir “moine escouillé” (soumis à l’abstinence sexuelle), ni mettre sa vie en danger au hasard de sanglantes batailles. De toute façon, tous croient alors en la prédestination, concept bien pratique pour ceux qui en bénéficient et accepté par le peuple, conditionné depuis l’enfance par la religion ayant bien labouré un cerveau vierge de toute instruction.
Les révoltes ne visent pas à renverser le système, mais à limiter ses injustices les plus criantes (prélèvements excessifs d’impôts, famines, corvées…). Si l’on avait demandé son avis au peuple de 1793, il n’aurait sans doute pas condamné le roi, tant celui-ci était perçu, depuis des siècles comme un rempart contre les abus des Grands (les grands aristocrates plus ou moins injustes et exploiteurs).
LA MERITOCRATIE, L’UTOPIE QUI MAINTIENT LA COHESION DU SYSTEME
Aujourd’hui, la démocratie – grâce au vote – permet de définir plus équitablement l’intérêt général que sous l’ancien régime. Toutefois, le système est loin d’être optimal.
- D’abord par la sur-représentation des catégories sociales aisées dans le profil des élus (surtout de la représentation nationale), soit par la sélection des études (ENA, Science Po), soit par celle de l’argent (Dassault) ou par la force du capital social – en gros – le carnet d’adresses (voir les dynasties familiales Kosciusco-Morizet, Zuccarelli ou encore Ceccaldi). Sans parler du clientélisme – porté à son comble par les grandes familles romaines – et si courant au plan local.
- Par l’évaporation des principes moraux dans l’ensemble de la classe politique, tous bord confondus. La liste des affaires est si longue qu’il est inutile de s’attarder. Les politiques défendent surtout leur propre intérêt et leur mauvais exemple se dissémine à travers l’ensemble de la société. “Pourquoi respecter les règles quand les gens d’en haut ne les respectent pas ?”. Etre honnête aujourd’hui, c’est être presque naïf et faible. Le discrédit qui frappe les politiques conduit à rejeter tout centralisme, et stratégie collective, ce qui menace la cohésion sociale dans son ensemble. Le libéralisme du chacun pour soi – déjà promu à l’échelle mondiale et accentué par depuis 1991 par la chute de l’empire soviétique et la dérèglementation financière mondiale – est accentué par la médiocrité de nos représentants.
- Par la manipulation démagogique et l’exploitation habile de l’ignorance du peuple et de sa porosité émotionnelle (revoir les excellents “à mort l’arbitre” ou “Dupont Lajoie” de Mocky et Chabrol). Promesses intenables (baisser les impôts, relancer la croissance), surenchère sécuritaire, bouc-émissarisation (étrangers, Bruxelles etc.)… De ce point de vue, certains médias mettent clairement de l’huile sur le feu avec des une racoleuses et démagogues.
- Par la persistance de l’idéologie méritocratique qui justifie les pires injustices. “Si on veut, on peut”, “je me suis fait tout seul”, “ils n’ont qu’à se bouger”… Idéologie profondément ancrée par l’héritage républicain et napoléonien (voir élitisme des grandes écoles). Et constitutive du libéralisme protestant qui infuse à travers le monde (relire le génial “Ethique protestante ou l’esprit du capitalisme” de Max Weber). Utopie qui maintient en place un système inégalitaire défendu à la fois par les nantis, mais aussi par les classes moyennes, surtout inquiètes d’être déclassées et de devoir payer pour les retardataires. Tout comme les paysans du moyen-âge qui défendirent jusqu’au bout une société profondément injuste, les classes moyennes valident un système inique, endoctrinées qu’elles sont par l’illusion de “l’égalité des chances” et la surestimation du mérite dans la réussite individuelle.
Mais aucune utopie n’est éternelle et quand celle-ci s’écroulera pour le plus grand nombre, (les 12 à 16% des plus défavorisés n’y croient plus depuis longtemps), c’est l’ensemble du système qui implosera. Je ne suis pas sûr de le souhaiter, mais je ne vois aucune alternative, pour le moment.
Cyrille Frank
Sur Twitter
Sur Facebook
Sur Linkedin
Sur Mediacademie.org (newsletter mensuelle gratuite des tendances, outils, modèles d’affaire du journalisme/production d’information)
A LIRE AUSSI
- Non aux ghettos culturels pour riches
- Nouveaux médias : une nouvelle classe de dominants
- Le plaisir, valeur refuge de nos sociétés en repli
- Les mécanismes séculaires de l’influence médiatique
Crédit photo en CC : Shandi-lee et Defenseinmages via Flickr.com
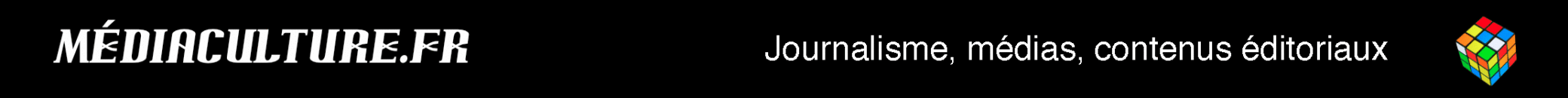


Comme toujours beaucoup de questions intéressantes dans votre billet. Je voudrais m’autoriser trois petits ajouts pour alimenter la réflexion.
1/ Communautarisme et aimer davantage son frère que son voisin …etc…
un propos qui renvoie à la question de l’identité, trop complexe pour être abordé dans le cadre d’un commentaire, mais qui a fait l’objet d’un développement intéressant dans le Monde Diplomatique de février 2014.
2/ Penser le bonheur du plus grand nombre renvoie à l’idée d’utopie, thème sur lequel j’ai essayé de réfléchir dans un billet intitulé «de nouvelles utopies sont-elles possibles?»
3/ Il y a également, je pense, un déterminant plus actuel et plus sournois dans l’essor de l’individualisme, qui se fonde sur l’évolution de la «pensée de projet».
Traditionnellement, le nombre de projets accessibles au commun des mortels était relativement limité et généralement associé aux perspectives familiales. Ces possibles se sont progressivement développés et diversifiés (les possibles de la consommation, l’accession à la propriété… ).
Le développement des outils disponibles (spécialement informatiques), des études, des réseaux traditionnels ou numériques, et surtout l’information tous azimuts, a augmenté, je crois, l’idée que chacun pouvait se faire de ses propres possibles.
Quand le nombre de possibles est perçu comme réduit, le consensus s’établit facilement, dans le cas contraire, chacun va privilégier le sien (les projets des autres sont alors facilement perçus comme sans objet, au mieux, comme des obstacles, au pire). Réaliser son projet propre passe par l’imposer à des projets concurrents…
Le cadre des projets dépasse alors celui de la famille… du couple… et, le manque d’imagination aidant se focalise sur le carriérisme professionnel… c’est-à-dire sur le contexte le plus concurrentiel qui soit… le plus frénétiquement individualiste… surtout quand l’offre d’emploi diminue.
Bonjour GV,
Je vous réponds très tardivement et je vous prie de m’en excuser. D’une part j’ai été assez accaparé dernièrement, et d’autre part, j’ai changé (malencontreusement) mes règles de modération, qui ne m’ont pas alerté de votre message.
Bref, c’est à moi de vous remercier et féliciter pour la qualité de vos relances !
Oui je souscris tout à fait à votre individualisme de projets lié à l’extension des possibles et à l’accroissement de la concurrence qui en résulte.
On le voit au niveau de la libéralisation de l’accès à la parole publique. Tout le monde ayant désormais la possibilité technique (et le temps) de s’exprimer, la concurrence fait rage : celle de l’attention.
Et cela est vrai au plan professionnel, au niveau des loisirs (tout le monde voyage aujourd’hui, ce qui fait la différence, c’est le voyage “hors-norme”, “authentique”, hors des sentiers battus, dont on se gargarise)…
La liberté pourrait être de vivre différemment et à côté. Mais dans nos sociétés grégaires, elle se traduit par un combat normatif pour s’imposer symboliquement (ou plus prosaïquement sur le plan économique).
Très bonnes fêtes à vous !
Cyrille
Whaou, j’applaudis. J’ai adoré chaque mot. Le genre de lecture qui faut du bien. Certaines personnes y voient encore clair. C’est bon de voir de la lumière allumée sur certains sites, d’y rentrer et de se sentir réchauffé.
Merci beaucoup Luigi ! :))
C’est votre commentaire qui me fait plaisir !
Pingback: - Croire ou ne pas croire, la raison ne fait rien à l’affaire