
Comme en témoigne le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) paru ce 4 octobre, il faut désormais compter avec les énergies renouvelables. Et ce, d'autant plus, souligne une étude de l'institut américain IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) parue ce même jour, que leur potentiel de désorganisation des marchés de l'électricité est sans commune mesure avec leur part dans la capacité de production installée. De plus en plus compétitives, elles bénéficient d'un coût marginal nul qui leur permet de grignoter petit à petit le taux d'utilisation des centrales thermiques, au point de menacer leur rentabilité, surtout sur les marchés où la demande en électricité stagne ou décline.
Quand les renouvelables menacent le royaume des énergies fossiles
Les auteurs de l'étude citent le cas du Texas. Au royaume des énergies fossiles, qui est en outre l'un des principaux marchés électriques du continent, le développement rapide du solaire et de l'éolien met peu à peu les centrales à charbon au chômage technique.
En Europe, les mêmes causes ont conduit à une baisse des prix sur les marchés de gros de l'électricité qui, de 80 euros le mégawhattheure (MWh) en 2008, évoluent aujourd'hui entre 30 et 50 euros/MWh.
Pour illustrer la violence des conséquences sur les marchés de l'électricité de l'effondrement des coûts des renouvelables, les auteurs se réfèrent aux exemples allemands, E.ON et RWE, qui ont tous deux choisi de se scinder en deux, afin de séparer les énergies nouvelles des énergies conventionnelles.
Les fruits d'une conversion précoce aux énergies vertes
Citant Standard & Poor's, l'étude rappelle les avantages dont bénéficient les opérateurs d'énergies renouvelables, notamment accroître leur capacité de production en les agrandissant ou en les rénovant, et jouer sur la complémentarité de leur portefeuille, le plus souvent composé de plusieurs technologies. Celles qui se sont positionnées le plus tôt ont pu en outre bénéficier de mesures particulièrement incitatives, telles que les tarifs de rachat particulièrement avantageux des premières années. Enfin, toujours d'après S&P, les entreprises ayant entrepris de mettre plus de vert dans leur portefeuille bénéficieraient de conditions de prêt plus intéressantes.
Pourtant, même si l'on a observé récemment une multiplication des acquisitions dans le secteur, les énergéticiens conventionnels ont longtemps considéré les renouvelables avec condescendance. A en croire l'IEFFA, ils ont de quoi le regretter. L'institut met en effet en évidence le lien entre la santé financière de ces entreprises et le sérieux et la précocité avec lesquels ils ont pris la mesure de la révolution qui se préparait.
150 milliards d'actifs dépréciés en Europe entre 2010 et 2016
IEEFA distingue deux excellents élèves : l'Italien Enel, dont 50% de la capacité de production est d'ores et déjà composée d'énergies renouvelables, vise une production totalement décarbonée. L'Américain NextEra est le plus gros producteur éolien du pays et possède également des fermes solaires en Floride et en Arizona. A l'inverse, le sud Africain Eskom est à leurs yeux coupable d'avoir raté le virage de la transition énergétique mais aussi de ne satisfaire ni ses clients ni ses actionnaires.
En Asie, la situation de Tepco, englué dans les retombées de la catastrophe nucléaire de Fukushima, s'oppose à cette d'AGL, un Australien initialement positionné exclusivement sur le charbon mais qui a pris le virage des renouvelables.
Les auteurs rappellent que l'Agence internationale de l'énergie a estimé à 150 milliards de dollars les dépréciations d'actifs enregistrées par les énergéticiens européens entre 2010 et 2016.
Conversion tardive mais résolue d'Engie
Concernant Engie, dont l'étude rappelle l'endettement, les auteurs saluent son orientation, tardive mais résolue, vers les énergies vertes.
Certes, des investissements relativement récents dans les énergies fossiles (acquisition d'International Power en 2012) et des dépréciations d'actifs fossiles ou nucléaires pour un total de 33 milliards d'euros de 2010 à 2016 ont plombé ses comptes et fait dévisser le cours de Bourse.
Mais le plan de transformation sur trois ans annoncé début 2016 tranche avec les années précédentes. Il s'est d'ores et déjà traduit par la vente d'actifs fossiles aux Etats-Unis, en Inde et en Indonésie, la fermeture emblématique de la centrale australienne d'Hazelwood, la mise en vente des actifs d'Engie Brasil et l'abandon de ses projets en Afrique du Sud et en Turquie. Le groupe s'est également désengagé de ses projets nucléaires en Angleterre et de sa participation dans Westinghouse.
Dans le même temps, les projets éoliens, solaires et même géothermiques se multiplient un peu partout, notamment en Inde grâce au rachat en 2015 de Solaire Direct, bien implantée dans le sous-continent. La prise de participation de 30% dans le Chinois Unisun en avril dernier ou l'acquisition de EV-Box, leader européen des bornes des recharge pour véhicules électriques, sont d'autres signes démontrant que la transition est engagée.
Le cours de Bourse comme témoin
D'ailleurs, IEEFA ne manque pas de souligner que les résultats semestriels d'Engie reflètent l'avancement de son plan de transformation, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse de respectivement 1,6% et 3,5%.
Sur la base des entreprises qu'ils ont étudiées, les chercheurs ont calculé que depuis 2007, la valeur boursière globale des principales entreprises de l'énergie avait fondu de 67%. Dans le même temps, celles cumulées de l'Italien Enel et l'Américain NextEra et de l'Australien AGL qui y est venu plus tardivement mais avec conviction, a bondi de près de 30%. De quoi rallier de nouveaux adeptes...

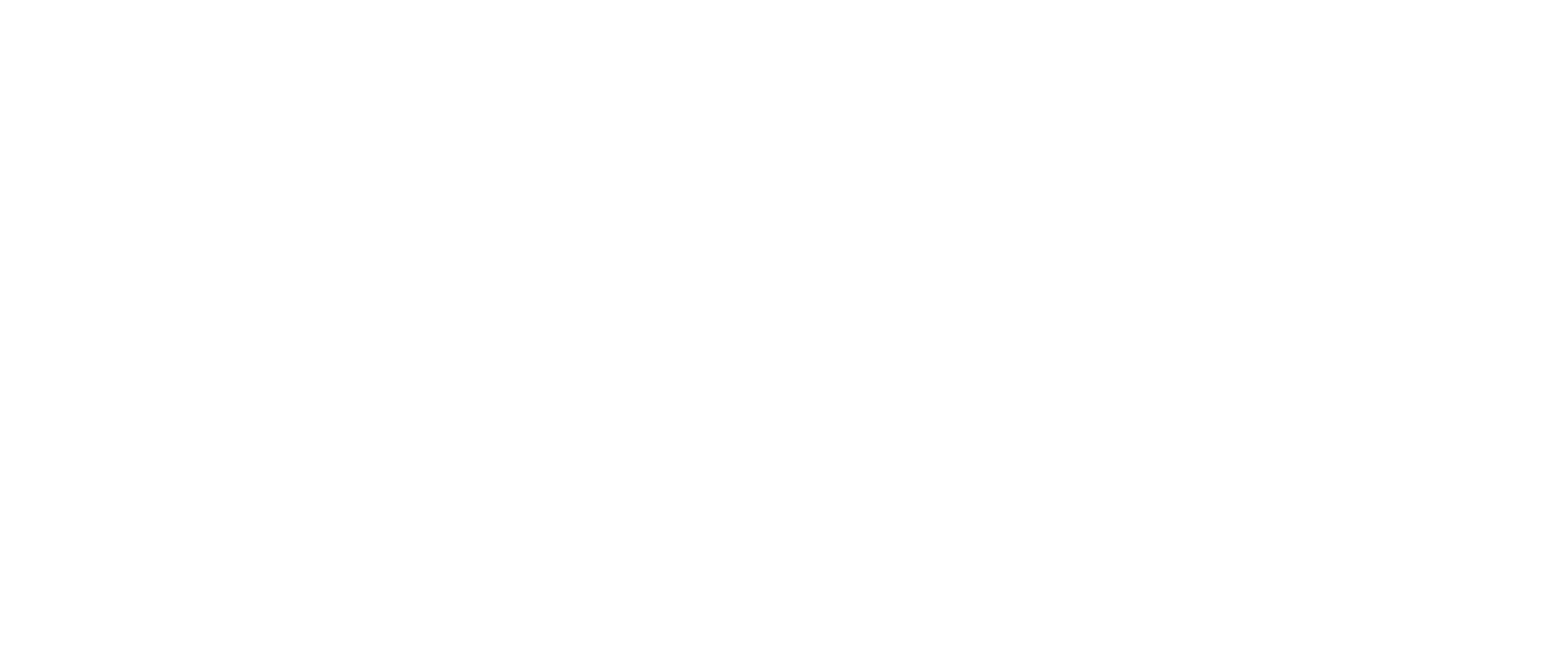


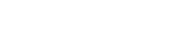
À l'inverse, dans les conditions de réglementations actuelles, les énergies pilotables classiques sont à la limite (ou en dessous) du seuil de rentabilité. Pourtant l'équilibre du réseau ne peut pas être maintenu sans elles.
Le jour où des coupures auront lieu à cause de ça, les politiques redécouvriront des contraintes physiques connues depuis toujours, modifieront la réglementation, et l'équilibre économique de tout ça basculera dans l'autre sens.
Le pire serait de se voiler la face à ce sujet.
L'arrivée de nouveaux opérateurs d’énergie tels le groupe Total, va certainement changer la donne et motiver les groupes historiques. Non pas qu'il arrive avec des technologies révolutionnaires, mais vu ses capacités financières il peur rapidement gagner des parts de marché, investir dans des projets de production d’électricité, tout en négociant aux mieux la fourniture de gaz.
Etant donné sa présence historique dans des pays producteurs d'hydrocarbures qui en plus bénéficient d'excellentes conditions ensoleillement. Certes il n’est pas le seul, mais il a l’avantage d’avoir déjà tissé des liens sur de nombreux continents.
Mais il faut faire vite car la concurrence est déjà rude, à voir le prix de revient extrêmement bas : 1,79 cents $/kWh atteint sur un appel d’offre de centrale photovoltaïque en Arabie Saoudite. Le record précédent devait être à Dubai à 2,99 cents le kWh ou à 29,1 $/MWh au Chili.
Certes ces tarifs ne sont pas transposables à la France, je crois qu’à Cestas on était à 10 cts/KWh et à 6,25 cts€ pour les derniers appels d’offres en solaire PV, mais il existe déjà des projets de raccordement trans-méditerranée. Cela avait été étudié dans le cadre du projet Desertec (https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2012-3-page-401.htm ) qui a depuis été abandonné je crois). Si le marché existe, des interconnexions électriques vont certainement se développer. (http://www.algerparis.fr/energie-agri/jean-louis-bal-la-transition-energetique-au-maghreb_a-232-5571.html) d’autant plus qu’avec la technologie courant continu (CCHT), les pertes en ligne sont moindres et que la technologie a déjà été mise en œuvre avec succès pour la liaison France/Espagne.
En France, déjà si on équipait les toitures, les ombrières de parkings et par exemple les bords d’autoroutes (étrange que Vinci énergie ne soit pas plus présent ?) avec du solaire photovoltaïque, cela permettrait à nos entreprise de s’inscrire dans la transition énergétique.
Qu’il y ait des dépréciations d’actifs dans le domaine des énergies conventionnelles qui puissent désespérer le monde de la gestion et des finances, en quoi ces mêmes responsables n’auraient-ils pas été en mesure de mieux le prévoir et de faire les investissements nécessaires qui leur auraient permis d’échapper à leur déboires ?
Visiblement un gros problème culturel de cloisonnement et de manque de communication intelligente entre les acteurs concernés du monde technologique, scientifique, industriel et financier. Si on a pu réduire autant les coûts de production pour les énergies renouvelables les plus modernes à 0.07€/KWh pour l’éolien et moins de 0.06€/KWh pour le solaire, on constatera néanmoins que c’est encore beaucoup trop cher pour permettre une plus grande accélération de la transition énergétique et pour pouvoir mieux rivaliser sur un plan strictement économique et financier avec les énergies plus conventionnelles.
Mais de constater aussi qu’il n’y a pas beaucoup de volontarisme financier à exploiter le développement de solutions nettement plus efficaces qui pourraient déjà exister et avec lesquels les profits financiers pourraient être boostés. Pour l’heure on attend que les nouvelles solutions arrivent « toutes seules » sur les marchés pour commencer à y regarder de plus près et de prendre souvent les décisions qui s’imposent bien trop tardivement.
Et de constater que beaucoup de financiers pensent encore que c’est irresponsable de leur part à s’intéresser aux aspects techniques même quand ils sont en rapport direct avec la profitabilité de leurs fonds de commerce.
Certes on aura toujours besoin d’un certain socle de production d’énergie non-intermittente, et que c’est peut être un nouveau type de nucléaire à la fois plus sûr, moins cher et qui produit nettement moins de déchets qui pourra le faire, mais que cela ne correspond pas aux filières à uranium enrichit même celles supposées correspondre aux améliorations les plus récentes et pour lesquelles les coûts les plus optimistes sont à 0.09€/KWh (Hinkley Point par exemple) et ceci sans prendre en compte les nombreuses autres aspects pris en charge par les états.
Bref tout comme ils n'ont pas vu arriver la manne d'internet et ce sont fait dépasser très rapidement par des acteurs qui sont devenus multimilliardaires en quelques années du coup, le mépris, ils n'ont pas voulu investir dans le renouvelable ce qui a permis à des acteurs moins gros de s'y engouffrer.
Hélas nous assistons à un rattrapage de ceux-ci qui avalent les PME liées au renouvelable mais non pas pour épanouir ce domaine d'activité mais comme à chaque fois pour conserver leur ancien business et sauver le pétrole et le nucléaire qui leur a couté si cher par le passé.
Le néolibéralisme c'est l'opposé du dynamisme, plus on possède et plus on est possédé.