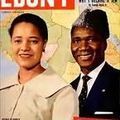Lisbonne : la "petite Suisse" des nouveaux riches Angolais
La nouvelle classe de superriches de l’Angola adore se rendre à Lisbonne. Pendant que les patrons font des affaires, leurs proches dévalisent les boutiques de luxe, relate Correio da Manhã.
Une heure dans la boutique Hugo Boss de l’avenue Liberdade à Lisbonne, et les 3 000 euros dépensés en tee-shirts, chemises et pantalons font briller de satisfaction les yeux de Luis Carlos. Les achats sont un cadeau de son oncle, chef d’entreprise angolais, qui à l’occasion d’un voyage d’affaires au Brésil a fait escale dans la capitale portugaise et rendu visite à son neveu de 24 ans, étudiant en informatique. Les intentions du jeune homme sont claires : retourner en Angola à la fin de ses études et se lancer dans les affaires familiales. “Ici c’est bien pour étudier et passer du bon temps, mais là-bas c’est mieux pour travailler.” La haute société angolaise vient donc dépenser son argent au Portugal. Les vols quotidiens en provenance de Luanda déversent une nouvelle vague de gens fortunés qui garantit la survie des boutiques de luxe de l’avenue Liberdade – la dixième artère la plus chère au monde. Et la Movida nocturne se nourrit des jeunes issus de l’élite angolaise, qui fréquentent des soirées où l’on entre sur invitation et où l’on consomme du champagne à 4 000 euros.
Le Portugal est en solde, avec des privatisations incluant notamment la principale compagnie aérienne, la TAP, l’EDP [l’équivalent d’EDF] et la REN [le gestionnaire public du réseau électrique], des banques en manque de capital, des industries en faillite ou un immobilier plus accessible qui attirent de plus en plus les Angolais. Selon l’Agence pour l’investissement et le commerce extérieur du Portugal (l’Aicep), entre janvier et juin 2011 les Angolais ont investi 35 millions d’euros. “Ils ont commencé dans l’immobilier, achetant des maisons, à Lisbonne la plupart du temps, pour leurs enfants qui viennent étudier ici, et maintenant ils s’attaquent à l’industrie et au secteur financier”, souligne Mira Amaral, président de la banque luso-angolaise BIC. A titre d’exemple, l’investissement angolais représente près de 10 % du secteur luxe de la société immobilière Century 21 au Portugal. Ce n’est pas un hasard si le président angolais, José Eduardo dos Santos, a été considéré comme le sixième homme le plus puissant de l’économie portugaise par le quotidien économique Jornal de Negócios. En 2010, 3,8 % de la Bourse portugaise était détenue par des capitaux angolais, suite, notamment, à l’entrée en force au Portugal d’Isabel dos Santos, la toute-puissante fille du président. Sans oublier les poids lourds politiques, comme Hélder Vieira Dias, chef du cabinet militaire du président angolais, qui possède des intérêts dans le vin et le secteur financier, ou les plus grosses fortunes du pays, comme la famille Van Dunen.
Pendant que des hommes du régime et des chefs d’entreprise traitent discrètement des affaires, installés dans des suites dont le prix oscille entre 400 et 1 000 euros, leurs femmes et leurs enfants dépensent sans modération dans Lisbonne et ses alentours.
Férues de marques internationales, les Angolaises sont considérées comme des reines dans les boutiques de luxe. Avenue Liberdade, Yumbe A., 33 ans, n’a pas assez de mains pour tenir sa fille Bruna, ses paquets de chez Dolce & Gabbana et son nouveau sac Prada de 2 000 euros. Elle vient régulièrement à Lisbonne, où il lui arrive de dépenser 5 000 euros par jour – ce qui vaut à cette informaticienne la bise à la sortie du magasin, l’appel d’un taxi et l’aide d’un employé pour placer ses affaires dans le coffre. “Ça vaut la peine de venir ici, car en Angola on n’a pas autant de grandes marques”, précise-t-elle.
C’est la discrétion et l’accueil personnalisé qui font le succès de la clinique du Tempo auprès des clients angolais. “Leur traitement préféré est le liposhape [la lipocavitation est une technologie indolore et non invasive qui élimine la cellulite et les dépôts de graisse], dont le prix est de 1 000 euros minimum. La stratégie de la clinique d’Humberto Barbosa passe par de la publicité en Angola et la décision de ne pas ouvrir d’établissement là-bas étant donné que les clients ‘préfèrent venir à Lisbonne, où la discrétion et qualité sont de mise’.”
Ana Vieira Dias, Eurico Araújo et Miriam Henriques, âgés de 18 et 19 ans, sont étudiants dans la banque, l’aéronautique et l’hôtellerie à Londres, mais ils ne ratent pas un été à Lisbonne. Ils ont leur maison sur place et en profitent pour faire leurs achats. “Ici, c’est beaucoup mieux, on connaît les endroits et les prix sont plus accessibles.” Luanda est considérée comme la ville plus chère du monde : un repas dans un restaurant normal coûte au minimum 30 dollars [22 euros]. Au Portugal, le luxe revient moins cher.
Isabel Faria et Marta Martins Silva
Source : CourrierInternationnal.fr
Chine - Afrique : La chine appelle à un regard impartial sur la coopération sino-africaine
WANNING, province de Hainan, 11 novembre (Xinhua) -- De hauts fonctionnaires chinois ont appelé vendredi les critiques à regarder les relations économiques entre la Chine et l'Afrique d'une façon objective, plutôt que de "politiser" la coopération sur la base de rumeurs sans fondement et de conjectures.
"La Chine, qui poursuit une voie de développement pacifique, ne reproduira jamais ce que les colonisateurs occidentaux ont fait en Afrique", a annoncé Lu Shaye, directeur général du département des Affaires d'Afrique du ministère chinois des Affaires étrangères, lors de la deuxième table ronde sur la coopération sino-africaine tenue à Wanning dans la province de Hainan (sud).
M.Lu considère la coopération entre la Chine et l'Afrique comme un "choix stratégique" pris par les deux parties, favorisant l'élévation des pays en développement comme un tout, et poussant le monde à se développer dans un sens "plus équilibré et raisonnable".
En tant que pays parmi tant d'autres ayant des relations avec l'Afrique, la Chine a l'esprit ouvert pour considérer la coopération avec les pays africains et leurs autres partenaires, a indiqué M. Lu.
Liu Guijin, envoyé spécial de la Chine pour les affaires d'Afrique, a reconnu que les ressources naturelles représentaient une partie importante des importations chinoises en provenance du continent africain, raison pour laquelle certains hommes politiques occidentaux versent dans la critique contre le gouvernement et les entreprises de la Chine.
"La racine de cette critique se trouve dans la structure commerciale imparfaite entre la Chine et l'Afrique, qui a longtemps existé", a rappelé M. Liu, ancien ambassadeur de la Chine au Zimbabwe et en Afrique du Sud, ajoutant que le problème ne peut pas être résolu "en une nuit", et que la Chine et les pays africains doivent s'efforcer conjointement de résoudre ce problème.
"Les pays africains doivent avant tout, diversifier leur propre structure économique et leurs produits afin d'améliorer la structure commerciale entre la Chine et l'Afrique", a indiqué M. Liu.
En réalité, le commerce africain avec d'autres pays, tels que les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne et la France, se caractérise également par le même problème, a affirmé l'envoyé spécial chinois.
Selon M. Liu, la Chine est en train de construire six zones de coopération économique et commerciale dans cinq pays africains afin d'améliorer les infrastructures locales et l'environnement de l'investissement de ces derniers.
Source : Frensh.news.cn
Audiovisuel : Rapport accablant de l'Inspection des finances sur France 24 et RFI
Dans un rapport commandé par Matignon, l'Inspection des finances fustige les dérives dans la gestion de l'audiovisuel extérieur.
Depuis un an, l'audiovisuel extérieur (qui rassemble France 24, RFI et TV5) a surtout fait parler de lui pour sa guerre des chefs opposant Alain de Pouzilhac et Christine Ockrent. Mais cette guerre cachait d'importantes dérives dans la gestion, à en croire un rapport que l'Inspection générale des finances (IGF) vient de remettre à Matignon après six mois d'enquête. Revue de détail des dérives constatées.
Les contrats de prestations externes : le rapport relève "plusieurs irrégularités". D'abord, des prestations ont été payées "en l'absence de contrats". Ensuite, certains marchés ont été attribués sans mise en concurrence, alors qu'il s'agissait d'une "obligation".
Les synergies : elles manquent cruellement dans plusieurs domaines, en particulier entre France 24 et TV5. Ainsi, "la seule synergie de contenu se limite à l'utilisation par France 24 de la météo internationale pour Internet produite par TV5". Les deux chaînes sont aussi "partiellement concurrentes" auprès des réseaux de distribution: câble, satellite... "Des effets de surenchère tarifaire entre les deux chaînes, ou même d'éviction réciproque, ont été constatés".
L'emploi : le rapport déplore que le premier plan social à RFI a coûté "nettement plus que prévu" : 41,3 millions au lieu de 30,2. Quant au plan social en cours, "son dimensionnement a manifestement davantage été déterminé en fonction d'un objectif d'économies à réaliser, qu'à partir d'une véritable analyse prospective", dénonce le rapport, pour qui "la masse salariale a servi de variable d'ajustement". En outre, 12 millions d'euros avaient été dépenses pour financer 153 départs transactionnels, dont beaucoup de dirigeants. "La quasi-totalité des membres du comité de direction a été renouvelée au moins une fois depuis 2008".
La publicité : les prévisions de la direction sur les recettes propres étaient "très optimistes", mais "la crédibilité de ce modèle a été rapidement remise en cause par les faits". Ainsi, en 2010, ces recettes propres ne se sont élevées qu'à 19 millions d'euros, "soit 40% de moins que la prévision de 32 millions". Cela est "d'autant plus préocuppant que la distribution et l'audience de France 24 ont fortement progressé. Ce qui fragilise le postulat selon lequel cette progression devrait faire affluer les recettes publicitaires". L'avenir n'est guère plus rose. Les prévisions ont été "fortement révisées à la baisse", passant pour 2013 de 39 à 19 millions. Mais l'IGF pense que c'est encore "particulièrement ambitieux" et "probablement trop optimiste". En effet, les recettes des premiers mois de 2011 sont à nouveau loin du budget. L'IGF craint donc que les prévisions de la direction soient encore surévaluées de 19,5 millions sur 2011-13.
Le dérapage des comptes : depuis 2009, la direction a demandé pas moins de 104 millions d'euros de "subventions exceptionnelles" à l'Etat (qui, à ce jour, lui en a accordé la moitié), pour des motifs divers: plans sociaux, déménagements, recapitalisation de RFI... Mais le rapport estime que les comptes pourraient encore déraper de 55 millions d'ici 2013, car il estime que certaines dépenses prévues restent minorées.
Mise à jour à 17h15:
L'audiovisuel extérieur a publié un communiqué dans lequel elle assure "partager plusieurs des analyses et recommandations du rapport de l’IGF, qui lui apparaissent pertinentes et de nature à favoriser un développement maîtrisé de ses entreprises. En revanche, l’Audiovisuel Extérieur de la France n’approuve pas certaines préconisations de ce rapport, qui reposent sur des analyses peu en phase avec la réalité des entreprises soumises à une concurrence internationale de plus en plus rude"
Jamal HENNI
Source : La Tribune
Sénégal : Celloun Dallein Diallo, meilleur investisseurs étranger . Où se trouve l'Amour de Dallein pour son pays
|
Au lendemain de sa défaite politique à la présidentielle de décembre dernier, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), El Hadj Cellou Dalein Diallo, le très ‘’charismatique’’ leader politique, a choisi délibérément de quitter son pays, pour se promener un peu partout, à travers le monde. Après ce que l’on pourrait qualifier le ‘’marathon politique’’ d’un leader digérant mal son échec, Cellou Dalein a regagné sa Guinée ‘’bien-aimée’’ le week-end dernier, avec une distinction de plus dans ses bagages : le titre de « Meilleur investisseur étranger au Sénégal ». |
INTERVIEW : QUAND LA FRANCAFRIQUE REGLE SES COMPTES
 " J' ai vu Chirac et Villepin compter les billets "
" J' ai vu Chirac et Villepin compter les billets "
L' Avocat Robert BOURGI racompte comment il a convoyé jusqu'à l'Elysée les moillions des chefs d'Etat africains. Le successeur de Jacques FOCCART, révèle vingt cinq ans de pratiques occultes sous Chirac. Pour la première fois, un homme avoue des financements occultes en provenance d'Afrique.
Pourquoi prendre la parole aujourd’hui?
Avant toute chose, je veux dire que je parle en mon nom personnel, je ne suis mandaté par personne. Pierre Péan, que je connais depuis vingt ans, est venu me voir pour son enquête sur Alexandre Djouhri et, de fil en aiguille, nous avons un peu parlé de quelqu’un que je connais bien, Dominique de Villepin. Depuis quelques jours, j’observe, je lis et j’entends les commentaires de ce dernier sur l’enquête de Pierre Péan. Trop, c’est trop. À 66 ans, j’en ai assez des donneurs de leçon et des leçons de morale… J’ai décidé de jeter à terre ma tunique de Nessus, cet habit qui me porte malheur et que je n’ai jamais mérité.
Dans le livre de Pierre Péan, vous racontez comment Villepin vous a déçu…
J’ai travaillé avec Dominique pendant des années. Nous avons été très proches, comme on peut être proche d’un ami, de quelqu’un que l’on connaît intimement. Et puis, fin 2005, brutalement, il m’a chassé. Oui, il m’a déçu. N’est pas de Gaulle qui veut. L’entendre donner des leçons, lui que je connais de l’intérieur, m’exaspère.
À quand remonte votre première rencontre?
En mars 1997, le jour de l’enterrement de mon maître, Jacques Foccart, Dominique de Villepin m’appelle et me dit qu’il m’attend le soir même dans son bureau. Ce soir-là, à l’Elysée, il y a Jacques Chirac. Le président me demande de reprendre le flambeau avec Villepin… Et souhaite que je l’initie à ce que nous faisions avec le "Doyen", comme j’appelais Foccart.
C’est-à-dire?
Pendant trente ans, Jacques Foccart a été en charge, entre autres choses, des transferts de fonds entre les chefs d’État africains et Jacques Chirac. Moi-même, j’ai participé à plusieurs remises de mallettes à Jacques Chirac, en personne, à la mairie de Paris.
«Il n’y avait jamais moins de 5 millions de francs»
Directement?
Oui, bien sûr. C’était toujours le soir. "Il y a du lourd?" demandait Chirac quand j’entrais dans le bureau. Il m’installait sur un des grands fauteuils bleus et me proposait toujours une bière. Moi qui n’aime pas la bière, je m’y suis mis. Il prenait le sac et se dirigeait vers le meuble vitré au fond de son bureau et rangeait lui-même les liasses. Il n’y avait jamais moins de 5 millions de francs. Cela pouvait aller jusqu’à 15 millions. Je me souviens de la première remise de fonds en présence de Villepin. L’argent venait du maréchal Mobutu, président du Zaïre. C’était en 1995. Il m’avait confié 10 millions de francs que Jacques Foccart est allé remettre à Chirac. En rentrant, le "Doyen" m’avait dit que cela s’était passé "en présence de Villepinte", c’est comme cela qu’il appelait Villepin. Foccart ne l’a jamais apprécié… Et c’était réciproque.
Pourquoi?
En 1995, Juppé et Villepin se sont opposés à ce que Foccart occupe le bureau du 2, rue de l’Élysée, qui était son bureau mythique du temps de De Gaulle et Pompidou. Le "Doyen" en avait été très amer. Il avait continué à apporter les fonds, mais il avait été humilié.
À combien évaluez-vous les remises d’argent de Foccart venant d’Afrique?
Incalculable! À ma connaissance, il n’y avait pas de comptabilité. Plusieurs dizaines de millions de francs par an. Davantage pendant les périodes électorales.
Jacques Chirac, accusé par Jean- Claude Méry dans sa fameuse cassette d’avoir vu une remise de 5 millions de francs, a toujours démenti tout cela…
Je sais ce que je dis. Je sais ce que j’ai fait.
«À l’approche de la campagne présidentielle de 2002, Villepin m’a carrément demandé "la marche à suivre»
Que faites-vous donc à partir de 1997, à la mort de Foccart, avec Dominique de Villepin?
Je l’ai présenté aux chefs d’État africains. Au début, ils se sont étonnés de devoir traiter avec Villepin, qui avait déjà son discours officiel sur la "moralisation"… Je leur ai dit que c’était une décision du "Grand", autrement dit de Chirac. Je dois dire que Villepin s’y est bien pris avec eux. Que le courant est bien passé. Il a su y faire… Il m’appelait "camarade" et s’est mis à m’offrir du whisky pur malt de 1963.
Et les remises de valises ont continué?
Elles n’ont jamais cessé. À l’approche de la campagne présidentielle de 2002, Villepin m’a carrément demandé "la marche à suivre". Il s’est même inquiété. C’est sa nature d’être méfiant. Je devais me présenter à l’Élysée sous le nom de "M. Chambertin", une de ses trouvailles. Pas question de laisser de traces de mon nom. Par mon intermédiaire, et dans son bureau, cinq chefs d’État africains - Abdoulaye Wade (Sénégal), Blaise Compaoré (Burkina Faso), Laurent Gbagbo (Côte d'Ivoire), Denis Sassou Nguesso(Congo-Brazzaville) et, bien sûr, Omar Bongo (Gabon) - ont versé environ 10 millions de dollars pour cette campagne de 2002.
Alors que ces fonds en liquide ne figurent sur aucun compte officiel, que les fonds secrets avaient été supprimés par Lionel Jospin, que l’affaire Elf avait mis en lumière les fortunes occultes des chefs d’État africains…
C’est l’exacte vérité. Un exemple qui ne s’invente pas, celui des djembés (des tambours africains). Un soir, j’étais à Ouagadougou avec le président Blaise Compaoré. Je devais ramener pour Chirac et Villepin 3 millions de dollars. Compaoré a eu l’idée, "connaissant Villepin comme un homme de l’art", a-t-il dit, de cacher l’argent dans quatre djembés. Une fois à Paris, je les ai chargés dans ma voiture jusqu’à l’Élysée. C’est la seule fois où j’ai pu me garer dans la cour d’honneur! C’était un dimanche soir et je suis venu avec un émissaire burkinabais, Salif Diallo, alors ministre de l’Agriculture. Je revois Villepin, sa secrétaire, Nadine Izard, qui était dans toutes les confidences, prendre chacun un djembé, devant les gendarmes de faction… Les tams-tams étaient bourrés de dollars. Une fois dans son bureau, Villepin a dit : "Blaise déconne, c’est encore des petites coupures!"
«Lors des grandes remises de fonds, j’étais attendu comme le Père Noël»
Comment écoulait-il ces fonds? Pierre Péan a demandé à Éric Woerth, trésorier de la campagne de 2002, qui n’a jamais eu vent de ces espèces…
Je ne sais pas ce que Chirac et Villepin en faisaient. C’est leur problème.
Vous dites que Laurent Gbagbo aussi a financé la campagne de Jacques Chirac en 2002…
Oui. Il m’avait demandé combien donnait Omar Bongo, et j’avais dit 3 millions de dollars. Laurent Gbagbo m’a dit : "On donnera pareil alors." Il est venu à Paris avec l’argent. Nous nous sommes retrouvés dans sa suite du Plaza Athénée. Nous ne savions pas où mettre les billets. J’ai eu l’idée de les emballer dans une affiche publicitaire d’Austin Cooper. Et je suis allé remettre le tout à Villepin, à l’Élysée, en compagnie d’Eugène Allou, alors directeur du protocole de Laurent Gbagbo. Devant nous, Villepin a soigneusement déplié l’affiche avant de prendre les billets. Quand on sait comment le même Villepin a ensuite traité Gbagbo, cela peut donner à réfléchir…
Jacques Chirac était-il au courant de toutes les remises d’espèces?
Bien sûr, tant que Villepin était en poste à l’Élysée. Lors des grandes remises de fonds, j’étais attendu comme le Père Noël. En général, un déjeuner était organisé avec Jacques Chirac pour le donateur africain, et ensuite, la remise de fonds avait lieu dans le bureau du secrétaire général. Une fois, j’étais en retard. Bongo, qui m’appelait "fiston" et que j’appelais "papa", m’avait demandé de passer à 14h 45. Nadine, la secrétaire de Villepin, est venue me chercher en bas et m’a fait passer par les sous-sols de l’Élysée. J’avais un gros sac de sport contenant l’argent et qui me faisait mal au dos tellement il était lourd. Bongo et Chirac étaient confortablement assis dans le bureau du secrétaire général de l’Élysée. Je les ai salués, et je suis allé placer le sac derrière le canapé. Tout le monde savait ce qu’il contenait. Ce jour-là, j’ai pensé au Général, et j’ai eu honte.
«Dominique est quelqu’un de double»
Après la réélection de 2002, Villepin a quitté l’Élysée pour le ministère des Affaires étrangères. Avec qui traitiez-vous?
Toujours avec lui. Cela a continué quand il est passé au Quai d’Orsay, à l’Intérieur, et aussi quand il était à Matignon. Place Beauvau, un nouveau "donateur", le président de Guinée équatoriale Obiang NGuéma, a voulu participer. J’ai organisé un déjeuner au ministère de l’Intérieur, en présence du président sénégalais Abdoulaye Wade et son fils Karim, au cours duquel Obiang NGuéma a remis à Villepin une mallette contenant un million et demi d’euros. Parfois, Dominique sortait directement l’argent devant nous, même si je venais accompagné d’un Africain, et, sans gêne, il rangeait les liasses dans ses tiroirs. Pour l’anecdote, je lui laissais parfois la mallette sans qu’il l’ouvre en lui donnant le code de la serrure… Une autre fois, lorsqu’il était à Matignon, Villepin s’impatientait parce que l’ambassadeur du Gabon était en retard. Il est finalement arrivé tout essoufflé avec un sac contenant 2 millions d’euros. "C’est lourd", disait-il… en frôlant l’infarctus.
À cette époque, en pleine affaire Clearstream, Dominique de Villepin a toujours évoqué les consignes présidentielles de "moralisation de la vie publique"…
Oui, en public, il a toujours eu ce discours. Dominique est quelqu’un de double. Un individu à deux faces. Pendant toute la période Clearstream, à plusieurs reprises, il était euphorique. "On va bourrer le nabot", disait-il en parlant de Nicolas Sarkozy. Il était certain, pendant des mois, que l’affaire Clearstream allait tuer politiquement son rival. Au total, après qu’il eut quitté l’Élysée, j’estime avoir remis à Villepin, en direct, une dizaine de millions de dollars. Et, outre cet argent liquide, je lui ai remis des "cadeaux"…
Quel genre?
Je me souviens d’un bâton du maréchal d’Empire, qui lui avait été offert par Mobutu. Bongoet Gbagbo lui ont aussi offert de superbes masques africains. Bongo lui a offert des livres rares, des manuscrits de Napoléon… Chirac a reçu des cadeaux splendides, aussi. Je me souviens d’une montre Piaget offerte par Bongo, qui devait réunir environ deux cents diamants. Un objet splendide, mais difficilement portable en France…
Comment savez-vous cela?
J’avais accès au gestionnaire du compte parisien d’Omar Bongo, et il m’est arrivé d’aider certaines personnes proches de Dominique, qui en avaient besoin. Avec "papa", nous avions un code: entre nous, nous appelions Villepin "Mamadou", parce qu’autrefois un secrétaire général du président gabonais se prénommait ainsi. Il me suffisait de dire : "Papa, 'Mamadou' a besoin de quelque chose." Et Omar Bongo me disait de faire le nécessaire.
«Grâce à son ingratitude, je suis allé voir Nicolas Sarkozy»
Vous disiez que les remises d’espèces ont continué quand Villepin était à Matignon...
Bien sûr. Les présidents africains avaient dans la tête que Villepin allait préparer la présidentielle. Omar Bongo, place Beauvau, lui avait dit : "Dominique, entends-toi avec Nicolas." Et Villepin lui avait ri au nez et lui avait répondu : "J’irai à Matignon, puis à l’Élysée." Il avait un sentiment de toute-puissance à cette époque. Je me souviens d’un jour, au Quai d’Orsay, où sa secrétaire m’appelle en urgence. "Camarade, un double whisky aujourd’hui, la ration John Wayne", me lance Dominique dans son bureau. Il avait quelque chose à me dire : "Aujourd’hui, j’ai atteint l’âge du général de Gaulle le jour de l’appel du 18 juin, j’ai 49 ans, Robert! Je serai l’homme du recours!" Il a prononcé plusieurs fois cette phrase – "Je serai l’homme du recours" – en imitant la voix du Général. En rentrant chez moi, j’ai dit à ma femme qu’il y avait peut-être un problème…
Comment cela s’est-il arrêté et pourquoi?
Fin 2005, la dernière semaine de septembre. Nadine, sa secrétaire, m’appelle selon le code : "Nous allons acheter des fleurs." Cela voulait dire que l’on se retrouve devant le Monceau Fleurs du boulevard des Invalides. Elle venait me chercher en voiture pour m’amener à Matignon. Ce jour-là, elle m’a fait entrer par l’arrière et m’a laissé dans le pavillon de musique. Villepin m’a fait attendre une demi-heure. J’ai tout de suite eu l’intuition qu’il y avait un problème.
Que s’est-il passé?
Il est arrivé et a lancé un drôle de "Alors, camarade, ça va?", avant de m’expliquer : "L’argent de Sassou, de Bongo, de tous les Africains, sent le soufre. C’est fini", a-t-il poursuivi… Je me souviens de sa phrase : "Si un juge d’instruction vous interroge, vous met un doigt dans le cul, cela va mal finir." Il parle exactement comme cela. Je l’ai bien regardé. Je lui ai dit qu’il m’emmerdait et je suis parti en serrant la mâchoire. Il m’a couru après en disant "camarade, camarade!", m’a rappelé cinq ou six fois dans les jours qui ont suivi. J’avais décidé que ce n’était plus mon problème. Grâce à son ingratitude, je suis allé voir Nicolas Sarkozy.
Comment cela?
Nicolas Sarkozy m’a écouté, je lui ai raconté tout ce que je vous raconte aujourd’hui. Même lui, il m’a paru étonné. Je l’entends encore me demander : "Mais qu’est-ce qu’ils ont fait de tout cet argent, Robert ?" Il m’a dit aussi : "Ils t’ont humilié comme ils m’ont humilié, mais ne t’inquiète pas, on les aura." Je l’ai revu la semaine suivante. Nicolas Sarkozy m’a dit : "Robert, là où je suis, tu es chez toi", et m’a demandé de travailler pour lui, mais sans le système de financement par "valises".
«L’argent d’Omar Bongo a payé le loyer pendant des années»
Les financements africains auraient-ils cessé pour la campagne de 2007? Difficile à croire… D’autant que Sarkozy, à peine élu, s’est rendu au Gabon et a annulé une partie de la dette gabonaise…
Je dis ce que je sais. Ni Omar Bongo ni aucun autre chef d’État africain, par mon intermédiaire, n’a remis d’argent ni à Nicolas Sarkozy ni à Claude Guéant.
Vous étiez proche de Laurent Gbagbo, vous n’avez pas été invité à l’intronisation d’Alassane Ouattara…
Laurent Gbagbo est un ami de trente ans. Il m’a raccroché au nez la dernière fois que je l’ai appelé. J’étais dans le bureau de Claude Guéant et c’était dans les derniers jours avant sa destitution… Il ne voulait plus prendre ni Sarkozy ni Obama au téléphone. Il ne voulait rien entendre et m’a dit : "C’est la dernière fois que je te parle." Par la suite, tout le monde le sait, Alain Juppé m’a fait enlever de la liste des invités pour l’intronisation de Ouattara.
Vous en voulez à Alain Juppé…
Lui aussi me fait sourire quand je l’entends donner des leçons de morale. Je vais finir par cette histoire qui remonte à 1981. Alain Juppé a pris la tête du Club 89, un cercle de réflexion de chiraquiens qui s’est installé dans de superbes locaux de l’avenue Montaigne. C’est moi qui ai signé le bail du loyer, qui était de 50.000 francs mensuels, une somme pour l’époque. D’ailleurs, le téléphone du 45, avenue Montaigne était à mon nom! L’argent d’Omar Bongo a payé le loyer pendant des années, entre 1981 et 1992. Les espèces du président gabonais ont fait vivre les permanents pendant des années… Le secrétaire général du Club 89, Alain Juppé, ne pouvait pas l’ignorer. Je sais qu’aujourd’hui tout le monde a la mémoire qui flanche. Moi, pas encore.
Laurent VALDIQUIE
Source : le JDD.fr
Les restrictions chinoises à l'exportation illégales, selon l'OMC
Un panel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) juge que les restrictions à l'exportation de certaines matières premières appliquées par la Chine sont contraires au droit du commerce international.
Cette décision annoncée mardi constitue une victoire pour les Etats-Unis, l'Union européenne et le Mexique.
"Le panel a déterminé que les taxes à l'exportation de la Chine étaient incompatibles avec les engagements pris par elle dans son protocole d'adhésion", explique l'OMC dans un communiqué.
"Le panel a également déterminé que les quotas à l'exportation imposés par la Chine sur certaines matières premières étaient incompatibles avec les règles de l'OMC".
Les USA, l'UE et le Mexique avaient saisi l'OMC en 2009, estimant que ses restrictions à l'exportation sur des minerais tels que la bauxite et le magnésium procuraient un avantage indu aux producteurs chinois vis-à-vis de leurs concurrents.
La Chine a déploré la décision de l'OMC, arguant que ses dispositions ne visaient qu'à protéger les ressources naturelles et l'environnement.
"La Chine est d'avis que, bien que ces mesures aient un certain impact sur les usagers nationaux et internationaux, elles sont conformes à l'objectif d'un développement durable promu par l'OMC et elles contribuent à orienter l'industrie des ressources naturelles vers un développement sain", lit-on dans un communiqué publiée par la délégation chinoise à Genève.
Il est probable que Pékin fera appel de cette décision.
Au contraire, le délégué américain au Commerce Ron Kirk a salué en la décision de l'OMC une "victoire importante".
"L'usage répandu de la Chine d'appliquer des restrictions à l'exportation pour un gain économique protectionniste est profondément dérangeant", dit-il dans un communiqué.
"La décision d'aujourd'hui du panel représente une victoire importante pour les industriels et leurs salariés aux Etats-Unis et dans le reste du monde".
Même réaction de satisfaction de la part du gouvernement allemand. "S'il (le jugement) est respecté, il y a une bonne chance que nous puissions réagir avec succès contre les restrictions chinoises à l'exportation des matières premières élémentaires", a déclaré le ministre de l'Economie Philipp Rösler.
La Chine produit 97% des terres rares dans le monde, des éléments vitaux pour les secteurs high tech. Pékin a réduit les quotas d'exportation de 35% au premier semestre, en sus de précédentes limitations.
Juliane von Reppert-Bismarck, Gernot Heller et Doug Palmer, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot
FMI : Christine Lagarde,son>
L’ancienne ministre de l’économie, Christine Lagarde est arrivée au siège du Fonds Monétaire International à Washington ce matin vers 9h (15h heure française).
Elle a été accueillie par son premier adjoint, l’Américain John Lipsky, et le doyen du conseil d’administration, l’Egyptien Abdel Shakour Shaalan. La crise de la dette grecque était à l’ordre du jour.
Une conduite éthique requise
Première femme à accéder à ce poste, Christine Lagarde touchera 467 940 dollars annuels ainsi qu’une allocation pour frais de représentation de 83 760 dollars, soit un salaire global de 551 700 dollars (380 000 euros). Une rétribution équivalente à celle de son prédécesseur, Dominique Strauss-Khan, démissionnaire après les accusations de viol porté contre lui pas la plaignante Nafissatou Diallo.
Les fonctions de Christine Lagarde restent globalement les mêmes que celles de DSK à l’exception d’un paragraphe sur l’éthique, beaucoup plus détaillé, indique le Parisien.fr. « Il est attendu de vous, en tant que directrice générale, que vous observiez les normes les plus élevées de conduite éthique, conformément aux valeurs d’intégrité, d’impartialité et de discrétion. Vous vous efforcerez d’éviter ne serait-ce que l’apparence d’une inconvenance dans votre comportement », exige le contrat.
Il semblerait que l’affaire DSK ait laissé des traces, le FMI a ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour s’éviter un nouveau scandale.
Laurence Riatto
ELLE.fr
Niger : L'économie mise à mal par la guerre en libye voisine
MALABO (Reuters) - La guerre en Libye voisine coûte à l'économie nigérienne des milliards de francs CFA en revenus perdus sur les transactions commerciales et les mandats envoyés jadis par les plus de 200.000 Nigériens travaillant dans ce pays et contraints de rentrer.
Ce bilan est dressé par le président Mahamadou Issoufou, interviewé ce week-end par l'agence Reuters en marge du 17e sommet de l'Union africaine réuni à Malabo, capitale de la Guinée-Equatoriale.
Les analystes estiment pour leur part que l'afflux dans la bande sahélo-saharienne d'armes et de munitions venues de Libye risquent d'aggraver l'instabilité du Niger où le secteur du tourisme est déjà en berne.
Le Niger, pays producteur d'uranium, reste l'un des pays les plus pauvres de planète avec notamment une crise alimentaire quasi-chronique.
"Il y a 211.000 émigrés qui sont rentrés au Niger et qui, traditionnellement, envoyaient dans leurs villages d'origine des mandats pour aider leurs familles", explique le président nigérien.
"Je ne connais pas le montant exact de ces transferts d'argent mais je sais que nous avons perdu beaucoup de milliards de FCFA en taxes à la suite de la crise libyenne et de la suspension des échanges commerciaux bilatéraux".
En mai, le Niger a dû réduire de 6,55% le budget 2011.
Autre victime collatérale de la guerre en Libye, la voie ferrée transsaharienne reliant la Libye au Niger sur 1.100 km et dont les travaux de construction sont suspendus.
La situation économique pâtit aussi du coup d'arrêt donné au secteur touristique après l'enlèvement d'Occidentaux en échange de rançons par des groupes liés à Al Qaïda.
"Nous sommes menacés par les islamistes, les contrebandiers et les groupes armés. Ces menaces ont été exacerbées par la crise en Libye (...) il faut trouver une solution politique", demande le président Issoufou.
David Lewis; Jean-Loup Fiévet pour le service français
France : Ce qui attend la nouvelle directrice du Fmi dans l'Affaire Tapie
Si la cour de justice de la république décide le 8 juillet d'ouvrir une enquête, la futur patronne du Fmi pourrait à terme être convoquée comme témoin assisté, voire mise en examen. Une hypothétique jugement ne pourrait intervenir que dans plusieurs années.
 Nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde reste sous la menace d'une enquête pénale en France dans l'affaire de l'arbitrage ayant rapporté 285 millions d'euros en 2008 à Bernard Tapie.
Nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde reste sous la menace d'une enquête pénale en France dans l'affaire de l'arbitrage ayant rapporté 285 millions d'euros en 2008 à Bernard Tapie.
L'ex-ministre de l'Économie est visée après la saisie de la Cour de justice de la République (CJR), qui juge les ministres en exercice. A l'initiative de cette demande d'enquête, le procureur général de la cour de cassation, Jean-Louis Nadal, qui suspecte un abus d'autorité dans le dossier de la vente litigieuse d'Adidas par le Crédit Lyonnais, alors banque public, en 1993.
Le procureur reproche à Christine Lagarde d'avoir choisi, pour régler le différend en 2007, la voie d'un arbitrage privé, contre l'avis des services de son ministère. Cette option avait été préférée par la ministre à la voie judiciaire, alors même que l'Etat avait gagné en 2006 en cassation. Il est aussi reproché à Catherine Lagarde de n'avoir pas exercé de recours contre la sentence arbitrale.
Trois options possibles
Comme le prévoit le fonctionnement de la CJR, la commission des requêtes saisie par Jean-Louis Nadal doit se prononcer le 8 juillet sur l'ouverture d'une enquête. Trois scénarios sont possibles :
- la commission juge qu'il n'y a pas matière à ouvrir une instruction et classe sans suite.
- insuffisamment informée, la commission demande à se faire communiquer des documents supplémentaires.
- la commission rend un avis favorable à l'ouverture d'une enquête.
Dans cette hypothèse, le procureur général de la Cour de cassation doit alors saisir une autre commission qui instruira le dossier. Cela signifie qu'à terme, Christine Lagarde pourrait être convoquée comme témoin assisté ou mise en examen. La nouvelle patronne du FMI ne bénéficie en effet pas, a priori, d'une immunité au FMI pour les faits commis avant son mandat.
Toutefois, même si le feu vert est donné à l'ouverture d'une enquête, Christine Lagarde devrait bénéficier d'un répit. En effet, Jean-Louis Nadal part en retraite le 30 juin et tant qu'il ne sera pas remplacé, l'enquête ne pourra pas démarrer effectivement car seul le procureur général peut rédiger le réquisitoire introductif saisissant la commission d'instruction. Or la nomination du nouveau procureur ne pourra pas intervenir avant l'automne en raison des procédures requises devant le Conseil supérieur de la magistrature. Parmi les potentiels candidats au poste de procureur général figure Jean-Claude Marin, considéré comme proche de l'actuelle majorité. Néanmoins, quel que soit le successeur de Jean-Louis Nadal, il sera obligé d'ouvrir l'enquête.
Dans tous les cas, s'il y a enquête, elle sera longue et, dans l'hypothèse où le dossier était renvoyé devant la formation de jugement, Christine Lagarde ne serait pas jugée avant plusieurs années. Sans oublier que pour des milliers de plaintes reçues, la CJR n'a pour l'instant jugé que six dossiers en 18 ans.
Source : Figaro.fr
Fmi : Les Défis qui attendent Madame Christine Lagarde à la tête de l'Institution
C'est fait. La ministre de l'économie a été officiellement nommée Directrice générale du fonds. Voici les quatre challenges qu'elle devra relever pour s'imposer.
Les Européens ont eu ce qu'ils voulaient : garder la direction du FMI à un moment où la zone euro s'enfonce dans la crise de la dette. Mais paradoxalement, Christine Lagarde devra se montrer d'autant plus ferme avec les pays européens en difficulté que de nombreux observateurs s'inquiètent de voir une directrice française se montrer trop indulgente avec sa région mère. De fait, le FMI a accordé 91,7 milliards de dollars prêts à l'Europe, soit un tiers des plans de sauvetage de la zone euro. Christine Lagarde en est consciente et a maintes fois souligné qu'elle saurait être dure. Et elle l'a répété jeudi lors de son "grand oral " jeudi devant le conseil d'administration : "Je ne suis ici pour représenter les intérêts d'aucune région du monde en particulier, mais bien l'ensemble des Etats membres". Et d'assurer : "Je ne me départirai pas de la franchise et de la vigueur nécessaires dans mes discussions avec les responsables européens, bien au contraire, a-t-elle déclaré. Il ne peut y avoir place pour la complaisance quand des choix douloureux doivent être faits, et il n'y a pas d'alternative à l'adoption, par les autorités grecques, d'ajustements difficiles mais indispensables pour restaurer la viabilité des finances publiques et la compétitivité du pays". Concrètement, à peine arrivée, Lagarde devra prendre une décision délicate sur le sort de la Grèce : faudra-t-il ou pas restructurer sa dette ? Mais il n'y a pas qu'avec la Grèce qu'elle sera amenée à se montrer tenace. Elle pourrait bien avoir à croiser le fer avec ceux qui vont lui succéder à Bercy, si ces derniers ne mènent pas les réformes jugées cruciales pour préserver le triple A de la dette française.
Convaincre les émergents
"Si je suis élue, je me consacrerai à continuellement adapter la représentation au sein du Fonds, en particulier les quotes-parts, à des réalités économiques changeantes", a-t-elle déclaré. Cela risque de sembler un peu hypocrite, puisque pour vraiment "adapter" le fonds aux nouveaux rapports de forces économiques, il aurait déjà fallu que Christine Lagarde laisse la direction du fonds à un émergent, comme son prédécesseur l'avait promis. N'empêche qu'il reste des progrès à faire en dehors de la question de la direction. Un rapport interne du FMI publié en mai conclut que la part des postes " senior " occupées par des employé d'Afrique, d'Asie de l'Est, du Moyen Orient et des " pays en transition " d'Europe de l'Est était encore beaucoup trop faible. Lagarde a fort intérêt à y remédier. Car à force d'être exclus des hauts postes des organisations internationales, de nombreux pays pourraient finir par se détourner complètement des institutions de Bretton Woods et créer leurs propres réseaux de coopération. De fait, l'Egypte a annoncé samedi qu'elle abandonnait ses demandes de prêts au FMI et à la Banque Mondiale. Elle se tourne en effet vers deux pays du Golfe : le Qatar avec des investissements de 10 milliards de dollars et l'Arabie Saoudite, avec près de quatre milliards de dollars d'aide sous forme de prêts à long terme et de dons.
Préserver la pertinence du Fonds
La sortie de DSK était certes peu glorieuse, mais le bilan de ses trois ans et demi à la tête du fonds est globalement positif. Saisissant l'occasion de la crise pour redonner un sens à une institution de plus en plus désuète, il en a faite un acteur incontournable du système financier mondial. Concrètement, cette réhabilitation de l'institution s'est traduit par le triplement de ses ressources : 500 milliards de dollars supplémentaires se sont ainsi ajoutés aux 250 milliards de dollars de ressources existantes. Christine Lagarde devra donc réussir à tirer les leçons de la crise pour que le FMI continue de jouer un vrai rôle. C'est pourquoi elle a évoqué devant le conseil d'administration la nécessité d'"une surveillance plus rigoureuse, efficace et cohérente [permettent] une meilleure prévention des crises et des conseils de politique sur mesure. Au-delà de sa mission primordiale d'assurer la stabilité des taux de change, le Fonds doit améliorer l'intégration de l'expertise sur le secteur financier dans sa surveillance".
Devenir économiste et visionnaire...
Mais Christine Lagarde arrivera-t-elle vraiment à imposer sa patte dans la doctrine du FMI ? Elle est ni économiste, ni banquière, mais avocate. Il faudra donc qu'elle prouve que son manque de diplôme d'économie n'est pas une faiblesse, voire même que c'est une force, en rappelant par exemple que le doctorat d'économie de l'Espagnol Rodrigo de Rato, directeur du fonds entre 2004 et 2007, ne lui a pas permis de prévoir la crise.
Sauf que l'expertise économique de DSK s'est indéniablement avérée précieuse pendant la crise. Il s'est adapté rapidement en prônant, dès 2008, la mise en place de plans de relance keynésiens. Son attitude audacieuse et en décalage avec l'orthodoxie libérale du Fonds a permis d'éviter de commettre les erreurs qui ont mené à la Grande Dépression de 1929.
Christine Lagarde a certes été ministre de l'Economie pendant quatre ans, un record, et elle s'est révélée être une négociatrice charismatique en situation de crise, mais elle n'a jamais formulé de visions fortes et personnelles. De fait, aucune loi ne porte son nom, la législation économique étant surtout définie par l'Elysée. Ce qui fait dire à ses détracteurs qu'elle n'a pas l'étoffe d'une patronne. Reste donc à voir si elle sera très influencée par le numéro 2. L'Américain David Lipton, le conseiller du président Obama pour le commerce extérieur, est pressenti pour le poste. Or cet ancien employé du FMI est connu pour ses positions dures et intransigeantes.
Source : l'Expansion.fr